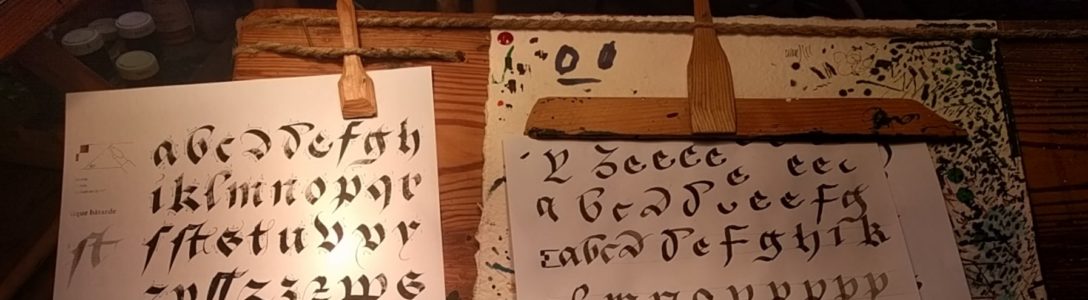Je rentre chez moi, me désétouffe et me laisse tomber sur mon lit, pas fait.
Les bruits de la rue passent par la fenêtre de la salle de bain, ouverte. Celle de ma chambre est fermée. Il fait bon. C’est un lieu familier, presque de recueillement, presque un sanctuaire, presque protégé.
Je connais sa géographie, tous ses recoins, son odeur, c’est à lui, à ce geste (me jeter sur mon lit) que je pense quand je veux m’isoler, flotter, souffler.
Je regarde l’heure : 17h. J’ai une heure.
J’ai une heure pour souffler, dormir. C’est trop court. C’est déjà une heure mais ça reste une limite proche. Je ne veux pas dormir, je veux flotter. Je suis allongé, écarté, écoutant, regardant. Mon esprit encamisolé est à l’image de ce lieu : limité, bridé. Mes pensées ne vont pas loin, tout comme mes pas si je me levais. Pour chimique, ces murs n’en sont pas moins réels, matérialisent le présent, limitent les errements.
De cris d’enfant, d’oiseaux. Je voudrais fermer la fenêtre mais j’ai la flemme, et je me dis : ceci est tout de même mon environnement, laissons-le entrer, restons en contact.
Les picotements dans mon crâne sont limités, une traînée de grains de sable plutôt qu’un habituel torrent de caillou. Parfois je ressens comme l’étalement d’une flaque d’eau, c’est l’arrivée d’un grand calme. Mais en ce moment pas de flaque d’eau, juste des traînées de sable, avec parfois une éclaircie : « reste calme », le futur en lequel j’ai confiance malgré tout : les prochaines fois où je la verrai, normalement, les prochaines étapes de nous dans quelques jours, ou mois, si proche mais qu’il est nécessaire que je visualise clairement sous peine de perdre pied, de perdre espoir.
« Reste calme », le temps d’une heure…